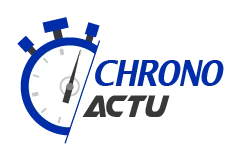Guerre en Ukraine : Que peut changer la requête ukrainienne de la Cour internationale de justice ?

- L’Ukraine accuse la Russie d’utiliser un faux prétexte – un « génocide » dans deux régions frontalières – pour justifier sur la scène internationale son action militaire.
- Si la requête peut mettre des années à aboutir, Kiev a demandé des « mesures conservatoires », une procédure d’urgence visant à « geler » la situation.
- Reste à savoir si la décision de la Cour internationale de justice, l’organe judiciaire des Nations Unies basé à La Haye, sera suivie d’effets.
Le droit pourrait-il être un levier pour mettre un terme à la guerre en Ukraine ou – a minima – contribuer à pacifier la situation ? C’est en tout cas l’une des options soulevées par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a déposé, samedi, une requête devant la Cour internationale de justice. « La Fédération de Russie a faussement affirmé que des actes de génocide avaient été commis » dans deux provinces ukrainiennes, le Louhansk et le Donetsk, peut-on lire dans ce document accessible sur le site de l’organisation internationale. Des accusations que l’Ukraine nie en bloc, affirmant, au contraire, être elle-même la cible d’un génocide planifiée par la Russie.
Kiev demande donc à l’organisation internationale d’établir que l’action militaire orchestrée par Vladimir Poutine pour « prévenir et réprimer un soi-disant génocide est dépourvue de tout fondement juridique » et donc contraire au droit international. « Depuis le début du conflit, on remarque que les deux Etats prennent soin de se placer du côté du droit international pour légitimer leur action », note l’avocat spécialisé en droit public Arnaud Gossement. Ainsi, jeudi, quelques minutes avant que les premières bombes ne s’abattent en Ukraine, le président russe expliquait au cours d’une déclaration surprise à la télévision avoir pris la décision d’une « opération militaire spéciale » pour défendre les « républiques » séparatistes autoproclamées victimes d’un « génocide », évoquant même une volonté de « dénazification » du pays.
Demande de mesures conservatoires
Or, dans ce dossier, les termes employés sont essentiels. Car la requête déposée par l’Ukraine ne porte pas sur la violation de la souveraineté d’un Etat ou même le respect des frontières, mais bel et bien sur la justification de l’action militaire. « La Cour n’est pas habilitée à se prononcer sur n’importe quelle violation du droit international dans ce conflit puisque aucun des deux pays n’a signé de déclaration reconnaissant sa compétence », décrypte Elsa Marie, docteure en droit public, spécialiste en droit international. En revanche, elle est compétente en cas de différend sur l’interprétation d’un traité international, ici la convention sur le génocide de 1948. « Elle peut dire si, oui ou non, il y a un génocide à l’œuvre dans ces régions et donc si l’intervention militaire pour le faire cesser est légale », résume Arnaud Gossement.
Reste que l’étude d’une telle requête peut prendre des mois voire des années. En 2017, l’Ukraine a ainsi déposé une requête contre la Russie concernant une violation d’un traité sur les discriminations raciales. Pour l’heure, la Cour s’est seulement déclarée compétente sur le sujet.
Cette fois, devant l’urgence de la situation, Kiev a introduit en parallèle une demande de « mesures conservatoires ». « Il s’agit d’une procédure d’urgence qui permet de geler la situation et d’éviter que les parties ne mettent en péril les droits en présence dans une affaire dans laquelle la Cour pourrait se prononcer », précise Elsa Marie. Si l’Ukraine a demandé que ces mesures soient étudiées sous sept jours, il n’y a cependant pas de délais précis dans cette procédure. « On est néanmoins dans une situation d’urgence avec des délais raccourcis, l’idée est que ça aille vite », précise la chercheuse.
Une requête pour quel effet ?
Reste une question, et non des moindres : si la Cour ordonne bel et bien des mesures conservatoires, celles-ci seront-elles suivies d’effets ? Théoriquement, les mesures prises par cette organisation, qui émane des Nations Unies, sont contraignantes. Mais dans les faits, la Cour ne dispose d’aucun moyen pour contraindre les Etats à s’y soumettre. Ainsi, si elle ordonne un cessez-le-feu le temps d’étudier la requête ukrainienne, qui le fera appliquer sur le terrain ?
« Il n’y a effectivement pas de force de police pour le faire appliquer mais une décision de la Cour internationale de justice reste un geste fort politiquement. Ce n’est pas pour rien que la Russie tente de justifier son action en droit », insiste Elsa Marie. Arnaud Gossement voit même dans cette décision un élément qui permettrait de participer à la résolution du litige. « Le droit est connecté au politique, à l’économie, c’est la raison pour laquelle même les régimes autocratiques ont besoin de s’en prévaloir. Plus cette décision aura d’écho, plus elle sera forte. »
NKN